lunes, 23 de noviembre de 2015
Jean-Paul Sartre
Philosophe, écrivain, journaliste, intellectuel modèle, militant, Jean-Paul Sartre a profondément influencé sa génération et celle qui a suivi. Il fut un maître à penser, un exemple suivi par une bonne partie de la jeunesse d'après-guerre. Se démarquant par le style particulier de son œuvre littéraire et de ses traités philosophiques, Sartre a surtout tenté d'illustrer sa philosophie par ses actions. Ainsi, ses divers engagements sociaux et politiques sont-ils inséparables de sa pensée. Plus que pour tout autre philosophe, il semble requis d’avoir une certaine idée du cheminement biographique du penseur pour prendre toute la mesure de la pensée sartrienne. Ce qui bien entendu ne dispense nullement de la lecture de ses œuvres. Le projet sartrien se développe dans trois horizons : la philosophie, la littérature et la politique.
Simone de Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée (1958).
Déguisée en chaperon rouge, portant dans mon panier galette et pot de beurre, je me sentais plus intéressante qu'un nourrisson cloué dans son berceau. J'avais une petite sœur : ce poupon ne m'avait pas.
De mes premières années, je ne retrouve guère qu'une impression confuse : quelque chose de rouge, et de noir, et de chaud. L'appartement était rouge, rouges la moquette, la salle à manger Henri II, la soie gaufrée qui masquait les portes vitrées, et dans le cabinet de papa les rideaux de velours; les meubles de cet antre sacré étaient en poirier noirci; je me blottissais dans la niche creusée sous le bureau, je m'enroulais dans les ténèbres; il faisait sombre, il faisait chaud et le rouge de la moquette criait dans mes yeux. Ainsi se passa ma toute petite enfance. Je regardais, je palpais, j'apprenais le monde, à l'abri.
2. panama : chapeau de paille importé de Panama.
3. Hélène, surnommée « Poupette ».
Mémoires d'une jeune fille rangée
Citations de Simone de Beauvoir sur la mort
Il n y a pas de mort naturelle : rien de ce qui arrive à l’homme n’est jamais naturel puisque sa présence met le monde en question. Tous les hommes sont mortels mais pour chaque homme sa mort est un accident et, même s’il la connaît et y consent, une violence inouïe
.
Je trouvais d'autant plus affreux de mourir que je ne voyais pas de raison de vivre.
Mémoires d'une jeune fille rangée (1958), Simone de Beauvoir, éd. Gallimard, coll. Folio, 2008, p. 480
Mémoires d'une jeune fille rangée
Première parution en 1958
Nouvelle édition en 2008
Collection Folio (n° 786), Gallimard
Parution : 10-01-2008
«Je rêvais d'être ma propre cause et ma propre fin ; je pensais à présent que la littérature me permettrait de réaliser ce vœu. Elle m'assurerait une immortalité qui compenserait l'éternité perdue ; il n'y avait plus de Dieu pour m'aimer, mais je brûlerais dans des millions de cœurs. En écrivant une œuvre nourrie de mon histoire, je me créerais moi-même à neuf et je justifierais mon existence. En même temps, je servirais l'humanité : quel plus beau cadeau lui faire que des livres? Je m'intéressais à la fois à moi et aux autres ; j'acceptais mon "incarnation" mais je ne voulais pas renoncer à l'universel : ce projet conciliait tout ; il flattait toutes les aspirations qui s'étaient développées en moi au cours de ces quinze années.»
Analyse et Résumé du Deuxième Sexe
Résumé du Livre 1 du Deuxième Sexe :
L’ouvrage est divisé en deux grandes approches. Le premier livre enquête sur les “Mythes et réalités” relatifs aux femmes générés par les points de vue anthropologique, biologique, psychanalytique, matérialiste, historique et littéraire. Dans chacune de ses analyses, De Beauvoir refuse le monisme causal : aucun d’entre eux ne suffit à expliquer l’oppression de la femme par l’homme, chacun participe de la construction de la femme comme Autre de l’homme. Ainsi, les différences biologiques (grossesse, allaitement, menstruation, …) contribuent à la différence homme/femme mais ne saurait justifier la hiérarchie homme/femme. La biologie ou l’histoire sont toujours interprétés d’un point de vue partial, celui de l’homme.
De Beauvoir analyse ensuite le rôle des mythes dans la construction de cette idéologie de la domination masculine, notamment le mythe de « l’éternel féminin». Ce mythe paradigmatique, qui intègre de multiples mythes de la femme (tels que le mythe de la mère, de la vierge, de la mère patrie, de la nature, etc.) tente de piéger la femme dans un idéal impossible en niant l’individualité et en refusant la singularité des femmes et de leurs situations. Ce mythe de l’éternel féminin a crée un idéal de femme, générant une attente toujours déçue. Les femmes réelles sont ainsi toujours perçues comme des fardeaux, des inachèvements.

Résumé du Livre 2 du Deuxième Sexe :
Le livre II commence avec la phrase la plus célèbre de Simone de Beauvoir, “On ne naît pas femme, on le devient“. De Beauvoir cherche à détruire l’essentialisme qui prétend que les femmes sont nées femmes, mais au contraire sont construites telles par l’endoctrinement social. De Beauvoir appuie cette thèse en retracant l’éducation de la femme depuis son enfance, en passant par son adolescence jusque dans ses relations sexuelles. A chaque étape, Beauvoir illustre comment les femmes sont forcées d’abandonner leurs revendications à la subjectivité transcendante et authentique au profit d’une acceptation d’un rôle «passif» et «aliéné», laissant à l’homme le rôle actif et subjectif. De Beauvoir étudie les rôles d’épouse, de mère, et de prostituée pour montrer comment les femmes, au lieu de se transcender par le travail et la créativité, sont réduites à des existences monotones, au rôle de mère et de maîtresse domestique et celui de réceptacle sexuel de la libido masculine.
Cependant, un malentendu commun sur De Beauvoir consiste à croire que la femme n’est plus libre. Il faut se souvenir que De Beauvoir est une philosophe existentialiste, autrement dit qu’elle considère la liberté ontologique des êtres comme absolues : l’homme ne détruit pas la liberté de la femme en objectivant la femme, mais il tente d’en faire un objet. La femme reste une transcendance, transcendée par la transcendance masculine, ou formulée autrement : une transcendance transcendée.
Néanmoins, et c’est là toute la complexité et subtilité de l’analyse de Beauvoir, les femmes peuvent être responsables et participer à leur propre sujétion. De Beauvoir distingue ainsi 3 conduite inauthentiques (Sartre dirait de mauvaise foi) dans lesquelles les femmes fuient leur condition de transcendance pour se fixer dans des croyances et des valeurs pré-déterminées. Ces trois attitudes, formant autant de tableaux sont : la narcissique, l’amoureuse et la mystique. Ces trois catégories ont en commun la fuite de leur liberté au profit de l’objet. Dans le cas de la narcissique, l’objet est elle-même, dans celui de l’amoureuse, son bien-aimé et dans celui de la mystique, l’absolu ou Dieu.
Exit la théorie : De Beauvoir formule en conlusion des recommandations pratiques pour favoriser l’émancipation de la femme. Tout d’abord, elle exige qu’on permette à la femme de transcender à travers ses propres projets. En tant que tel, la femme moderne “se targue de penser, d’agir, de travailler, de créer dans les mêmes conditions que les hommes. Au lieu de chercher à les dénigrer, elle se déclare leur égal”.
Afin d’assurer l’égalité de la femme, Simone de Beauvoir préconise de tels changements dans les structures sociales telles que la légalisation de la contraception et de l’avortement, la liberté économique de la femme et son indépendance à l’égard de l’homme. En ce qui concerne le mariage, De Beauvoir le voit comme un obstacle à la libération des femmes car il fixe dans une institution les rôles archaïques de mari, patron de la famille, et celui de l’épouse, son esclave domestique.
Le livre II commence avec la phrase la plus célèbre de Simone de Beauvoir, “On ne naît pas femme, on le devient“. De Beauvoir cherche à détruire l’essentialisme qui prétend que les femmes sont nées femmes, mais au contraire sont construites telles par l’endoctrinement social. De Beauvoir appuie cette thèse en retracant l’éducation de la femme depuis son enfance, en passant par son adolescence jusque dans ses relations sexuelles. A chaque étape, Beauvoir illustre comment les femmes sont forcées d’abandonner leurs revendications à la subjectivité transcendante et authentique au profit d’une acceptation d’un rôle «passif» et «aliéné», laissant à l’homme le rôle actif et subjectif. De Beauvoir étudie les rôles d’épouse, de mère, et de prostituée pour montrer comment les femmes, au lieu de se transcender par le travail et la créativité, sont réduites à des existences monotones, au rôle de mère et de maîtresse domestique et celui de réceptacle sexuel de la libido masculine.
Cependant, un malentendu commun sur De Beauvoir consiste à croire que la femme n’est plus libre. Il faut se souvenir que De Beauvoir est une philosophe existentialiste, autrement dit qu’elle considère la liberté ontologique des êtres comme absolues : l’homme ne détruit pas la liberté de la femme en objectivant la femme, mais il tente d’en faire un objet. La femme reste une transcendance, transcendée par la transcendance masculine, ou formulée autrement : une transcendance transcendée.
Néanmoins, et c’est là toute la complexité et subtilité de l’analyse de Beauvoir, les femmes peuvent être responsables et participer à leur propre sujétion. De Beauvoir distingue ainsi 3 conduite inauthentiques (Sartre dirait de mauvaise foi) dans lesquelles les femmes fuient leur condition de transcendance pour se fixer dans des croyances et des valeurs pré-déterminées. Ces trois attitudes, formant autant de tableaux sont : la narcissique, l’amoureuse et la mystique. Ces trois catégories ont en commun la fuite de leur liberté au profit de l’objet. Dans le cas de la narcissique, l’objet est elle-même, dans celui de l’amoureuse, son bien-aimé et dans celui de la mystique, l’absolu ou Dieu.
Conclusion sur Le Deuxième Sexe : un manifeste pratique
Exit la théorie : De Beauvoir formule en conlusion des recommandations pratiques pour favoriser l’émancipation de la femme. Tout d’abord, elle exige qu’on permette à la femme de transcender à travers ses propres projets. En tant que tel, la femme moderne “se targue de penser, d’agir, de travailler, de créer dans les mêmes conditions que les hommes. Au lieu de chercher à les dénigrer, elle se déclare leur égal”.
Afin d’assurer l’égalité de la femme, Simone de Beauvoir préconise de tels changements dans les structures sociales telles que la légalisation de la contraception et de l’avortement, la liberté économique de la femme et son indépendance à l’égard de l’homme. En ce qui concerne le mariage, De Beauvoir le voit comme un obstacle à la libération des femmes car il fixe dans une institution les rôles archaïques de mari, patron de la famille, et celui de l’épouse, son esclave domestique.
La femme se détermine et se différencie par rapport à l’homme et non celui-ci par rapport à elle..
Le Deuxième Sexe. Le plus grand livre de la philosophie féministe
« La femme se détermine et se différencie par rapport à l’homme et non celui-ci par rapport à elle; elle est l’inessentiel en face de l’essentiel. Il est le sujet, il est l’Absolu: elle est l’Autre »
De l’accord des philosophes contemporains, Le Deuxième Sexe de Simone De Beauvoir est une œuvre révolutionnaire, car elle est la première féministe qui parvient à justifier ses positions par des thèses philosophiques et historiques. le deuxième Sexe a une influence considérable sur les générations de femmes qui lui ont succédées. De Beauvoir défend la thèse suivante : l’inégalité homme/femme est historiquement et idéologiquement construite. Les femmes doivent reprendre possession de leur destin, non en tant que femme, mais en tant qu’homme comme les autres. Ainsi, la femme ne doit plus être « femme », autrement dit le sexe inférieur, l’Autre, mais un homme.
Publié en deux volumes en 1949, ce travail a immédiatement trouvé à la fois un public enthousiaste et des critiques très sévères. Le Deuxième Sexe a été si controversé que le Vatican l’a classé dans la liste de ses romans interdits.
En outre, Simone de Beauvoir affirme que l’existence humaine est un jeu ambigu entre la transcendance et l’immanence, mais les hommes ont eu le privilège d’exprimer la transcendance à travers des projets, tandis que les femmes ont été contraintes à la vie répétitive et peu créative de l’immanence. De Beauvoir propose donc d’étudier comment cette relation radicalement inégale a émergé et comment elle se traduit.

De "Comment les femmes auraient-elles jamais..." à "...qu'on lui laisse enfin courir toutes ses chances."
Le deuxième sexe
Simone de Beauvoir, 1949
Analyse de la phrase:
De "Comment les femmes auraient-elles jamais..." à "...qu'on lui laisse enfin courir toutes ses chances."
IntroductionPhilosophe et romancière, compagne de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir a beaucoup contribué à la lutte pour la reconnaissance des femmes. Le deuxième sexe est un essai dans lequel elle analyse toutes les formes d’assujettissement dont les femmes ont été et sont encore l’objet à son époque. Elle répond dans ce passage à ceux qui s’étonnent du petit nombre de génies artistes féminins, en définissant les données d’un problème sociologique.
Lecture du texte
L’étude suivra le mouvement du texte.
Etude
I - La femme assujettie (dominée)
1) La demande argumentative
Simone de Beauvoir a un constat : peu de femmes sont des génies artistiques et elle propose une explication : c’est parce qu’elles sont dominées.
Pour soutenir (étayer) sa thèse elle utilise trois exemples :
- Les Américains colonisés par les Anglais (18ème siècle)
- Les noirs esclaves des Etats-Unis
- Le prolétariat
Ces groupes n’ont pas été en mesure de créer parce qu’ils étaient assujettis.
Elle énonce une loi générale à partir d’exemples.
2) Les conditions de la création
Elle répète cette idée à plusieurs reprises, l’idée de libération : (ligne 7) « la femme libre est seulement en train de naître », (ligne 4) « laisser-nous exister ».
Tout cela demandera du temps.
II - L’avenir de la femme
1) La prophétie de Rimbaud
Elle annonce « la fin de l’infini servage de la femme » dans un futur non précisé, son avenir de poète, et affirme que la femme « trouvera l’inconnu », idée soulignée par le la série d’adjectifs de la ligne 12. La forme de la question à la ligne 11 semble attendre une réponse affirmative.
2) Attitude de Simone de Beauvoir face à cette déclaration
Elle est ambiguë : elle choisit cette déclaration de Rimbaud car elle va dans son sens et parce que Rimbaud est un poète reconnu et incontesté, c’est une sorte d’argument d’autorité. Mais en même temps elle exprime des réticences et ne reprend pas complètement la citation à son compte. Elle se montre réservée sur l’idée que les mondes d’idée féminins différeront de ceux des hommes.
Il y a le modalisateur (ligne 13) « il n’est pas sûr que », la nuance (ligne15) « dans quelle mesure », l’expression (ligne16) « des anticipations biens tandis ».
Ces trois derniers montrent qu’elle n’adhère pas complètement à la thèse de Rimbaud sans toutefois la rejeter.
En revanche, elle termine en réaffirmant que la libération de la femme est nécessaire pour elle mais aussi pour tout le monde.
Conclusion
Si Simone de Beauvoir est sûre que parmi les femmes libérées naîtront des artistes, comme chez les hommes, elle reste plus réservée sur les formes de leur production. Le texte a été écrit en 1949, on peut maintenant se demander si le demi-siècle qui s’est écoulé depuis lui a donné raison.
Résumé Le Deuxième Sexe
Essai écrit par Simone de Beauvoir, paru en 1949.
C'est l'une des œuvres les plus célèbres et les plus importantes pour le mouvement féministe. De nos jours, elle est souvent employée comme référence dans le discours féministe. En fait, c'est elle qui est à l'origine du surnom de « mère spirituelle » de la deuxième vague féministe attribué à Simone de Beauvoir.
Cette œuvre est non seulement célèbre mais aussi très controversée et cela depuis sa publication. En fait, c'est surtout à cause de la célébrité de l'œuvre que Simone de Beauvoir a dit que Le Deuxième Sexe est l'œuvre dont elle était la plus satisfaite. Beauvoir et son ami, compagnon et amant, l'existentialiste Jean-Paul Sartre, ont toujours écrit des œuvres sur des thèmes importants de l'actualité de la société française et ont, à cause de cela, été appelés des écrivains engagés.
Le Deuxième Sexe porte sur les différentes raisons de l'infériorité de la femme dans la société et dans presque tous les domaines hors de la maison. Cette œuvre affirme que ce sont les hommes qui gèrent le monde et que la femme a la tentation de se consacrer entièrement à son mariage et à ses enfants, au risque de limiter sa liberté. Cette situation vient simplement du fait qu'elle ne se sent pas capable ou bien qu'elle ne désire pas rester célibataire pour des raisons économiques et/ou sociales. La société, les parents, la religion, tout réaffirme aux femmes qu'elles sont inférieures aux mâles et qu'elles devront avoir un mari. Le développement des filles par rapport aux garçons et au monde qui les entoure leur démontre à elles et à la société que la femme n'a pas les mêmes capacités que l'homme. Beauvoir parle de toutes les circonstances qui amènent les gens à croire à l'infériorité des femmes et des effets que cela a sur le choix des femmes de se marier et d'abandonner leur propre carrière.
De plus, l'œuvre parle du piège que représentent pour elles le mariage et les enfants. Le mariage et les enfants sont des responsabilités beaucoup plus lourdes pour elles que pour les hommes et c'est en partie à cause de leur rôle à la maison qu'elles ne se réalisent pas comme individus hors de la maison. La plupart du temps la femme sacrifie sa carrière pour celle de son mari. Simone de Beauvoir parle de la situation globale des femmes et se rend compte que l'homme et la femme sont tous les deux responsables de cette situation. La femme ne devrait pas abandonner sa carrière pour son mari et ses enfants et l'homme ne devrait pas l'encourager à le faire. De plus, Simone de Beauvoir explique que, dans un monde où les deux sexes seraient égaux, les deux seraient plus libres. Elle explique que si l'homme donne l'opportunité aux femmes d'avoir une carrière significative, elle va moins se focaliser sur lui et elle pourra être un peu plus indépendante.
Il y a dans Le Deuxième Sexe de nombreux autres arguments pertinents qui démontrent l'inégalité des sexes en raison de la division des tâches à la maison et de la faible participation des femmes dans plusieurs autres domaines comme le travail ou la politique. On voit, par exemple, que les plus hauts postes sont pour la plupart réservés aux hommes. Il y a donc toujours une inégalité qui existe et il faut essayer de la comprendre pour ainsi savoir comment corriger la situation à l'avenir. Le Deuxième Sexe est une œuvre qui parle des problèmes de la femme et continue encore à être une analyse pertinente et utile de ce thème.
À propos de la réception critique de l'ouvrage, se reporter à Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, textes réunis et présentés par Ingrid Galster (Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2004) où sont présentés, entre autres, les articles contradictoires de Armand Hoog et Francine Bloch parus dans le même numéro.
Le Deuxième Sexe, 1949
On ne naît pas femme : on le devient.
Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir, éd. Gallimard, 1950, t. II. L'expérience vécue, partie première: Formation, chap. premier: Enfance, p. 13
Le propre des manies et des vices, c'est d'engager la liberté à vouloir ce qu'elle ne veut pas.
Le Deuxième Sexe (1949), Simone de Beauvoir, éd. Gallimard, coll. Folio, 1976, t. II. L'expérience vécue, p. 266
La femme est vouée à l'immoralité parce que la morale consiste pour elle à incarner une inhumaine entité : la femme forte, la mère admirable, l'honnête femme etc.
Le Deuxième Sexe (1949), Simone de Beauvoir, éd. Gallimard, coll. Folio, 1976, t. II. L'expérience vécue, p. 310
C'est la femme qui travaille – paysanne, chimiste ou écrivain – qui a la grossesse la plus facile du fait qu'elle ne se fascine pas sur sa propre personne ; c'est la femme qui a la vie personnelle la plus riche qui donnera le plus à l'enfant et qui lui demandera le moins, c'est celle qui acquiert dans l'effort, dans la lutte, la connaissance des vraies valeurs humaines qui sera la meilleure éducatrice.
Le Deuxième Sexe (1949), Simone de Beauvoir, éd. Gallimard, coll. Folio, 1976, t. II. L'expérience vécue, p. 384
L'histoire secrète du manifeste des 343 , 1971
Un million de femmes se font avorter chaque année en France.
Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes.Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre.
Le manifeste des 343, Simone de Beauvoir, éd. Le Nouvel Observateur, 1971, p. Introduction
Jean Moreau, c'était la grande gueule de "l'Obs", l'éternel révolté. Un journaliste comme on n'en fait plus, ce fils de garagiste avait débuté à la documentation de "l'Express", avant de diriger celle du journal de Jean Daniel. Un drôle de zébulon, ami de Sartre et Glucksmann, un cégétiste apprécié de ses patrons, qui passait sa vie dans les usines, les manifs, sur les grands boulevards à distribuer "la Cause du peuple".
Jean, c'était celui avec qui on aimait refaire le monde, celui à qui on venait raconter sa vie. Les filles surtout. Elles se savaient en confiance, cet homme-là avait lu et relu "le Deuxième Sexe". Elles pouvaient tout lui dire : l'amour souvent gâché par le manque d'insouciance, le plaisir surveillé, la peur obsessionnelle du ventre qui enfle.
De la préhistoire pour les jeunes générations... Pourtant, ce n'est pas si loin. Fin des années 1960, début des années 1970, on prônait l'amour libre sans en avoir les moyens. Malgré la loi Neuwirth sur la contraception et les campagnes d'information du Planning familial, seules 6% des femmes prenaient la pilule. "Ici Paris" et "France Dimanche" la disaient alors dangereuse et inefficace. On baisait, en priant le ciel que ça n'arrive pas... Celles qui "tombaient" enceintes n'avaient qu'un choix : garder l'enfant ou braver la loi.
Les privilégiées partaient en Grande-Bretagne ou en Suisse, trouvaient dans leurs relations un médecin qui, moyennant finance, acceptait de faire le sale boulot. Les autres bricolaient, des aiguilles à tricoter, une sonde, des pastilles d'eau de Javel... Beaucoup y perdaient leur fécondité et, dans 1 cas sur 1.000, leur vie. Après des années de silence, l'opinion publique découvrait l'horreur des avortements clandestins grâce notamment aux féministes.
"Il se passe quelque chose dans mon ventre"
Personne ne pourrait aujourd'hui entendre ces filles qui hurlaient : "Il se passe quelque chose dans mon corps, une croissance, un processus biologique qui m'est intolérable. Je veux donc l'enlever de là... malheureusement, me dit-on, c'est un futur être humain, il appartient à la collectivité. Que la collectivité fasse des oeufs, qu'elle les féconde, qu'elle vomisse le matin..."
Il fallait bien ça pour lutter contre tous ces cathos, ces salauds, ces machos... En face, on ne faisait pas non plus dans la dentelle. A Assas, les militants de Laissez-les vivre ! faisaient monter une jeune handicapée sur une estrade et demandaient : "Alors tu n'es pas heureuse de vivre?" Une centaine de personnalités révoltées par le projet de loi Peyret (qui proposait de légaliser l'avortement dans certaines conditions, en cas de viol ou d'inceste, notamment) dénonçaient, à l'automne 1970, "cette tentative de légalisation du meurtre, premier pas dans la voie de l'extermination idéologique qui, après les bébés mal aimés, prendra pour cibles les infirmes et les impotents, les débiles mentaux et les clochards...".
"Sales connes, hurle Mafra, la complice d'Anne Zelensky, je vous dégueule dessus, tas de bourgeoises, vous, vous pouvez toujours vous payer un avortement!" Un petit groupe décide quand même de tester l'idée auprès de Simone de Beauvoir. L'icône du féminisme français les reçoit dans son duplex de la rue Schoelcher. Le Castor, avec ses petits yeux bleus, son chignon impeccable, va, comme toujours, droit au but : "Eh bien, je trouve l'idée très bonne. Et je vais vous aider."
 Première étape : écrire le "Manifeste". Dans le petit groupe fondateur, l'écrivain Christiane Rochefort et la comédienne Christiane Dancourt plaident pour une phrase unique : "Je me suis fait avorter." Faut-il être plus revendicative, faut-il inclure les hommes ? Une version commençant par : "Je déclare avoir été complice de l'avortement d'une femme...", signée par François Truffaut et Sami Frey, circule. Mais c'est Simone de Beauvoir qui rédige la version finale. En quelques phrases, tout est dit : "Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses... On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles, je déclare avoir avorté."
Première étape : écrire le "Manifeste". Dans le petit groupe fondateur, l'écrivain Christiane Rochefort et la comédienne Christiane Dancourt plaident pour une phrase unique : "Je me suis fait avorter." Faut-il être plus revendicative, faut-il inclure les hommes ? Une version commençant par : "Je déclare avoir été complice de l'avortement d'une femme...", signée par François Truffaut et Sami Frey, circule. Mais c'est Simone de Beauvoir qui rédige la version finale. En quelques phrases, tout est dit : "Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses... On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles, je déclare avoir avorté."
La peur du ventre qui enfle
Jean Moreau, c'était la grande gueule de "l'Obs", l'éternel révolté. Un journaliste comme on n'en fait plus, ce fils de garagiste avait débuté à la documentation de "l'Express", avant de diriger celle du journal de Jean Daniel. Un drôle de zébulon, ami de Sartre et Glucksmann, un cégétiste apprécié de ses patrons, qui passait sa vie dans les usines, les manifs, sur les grands boulevards à distribuer "la Cause du peuple".
Jean, c'était celui avec qui on aimait refaire le monde, celui à qui on venait raconter sa vie. Les filles surtout. Elles se savaient en confiance, cet homme-là avait lu et relu "le Deuxième Sexe". Elles pouvaient tout lui dire : l'amour souvent gâché par le manque d'insouciance, le plaisir surveillé, la peur obsessionnelle du ventre qui enfle.
Garder l'enfant ou braver la loi
De la préhistoire pour les jeunes générations... Pourtant, ce n'est pas si loin. Fin des années 1960, début des années 1970, on prônait l'amour libre sans en avoir les moyens. Malgré la loi Neuwirth sur la contraception et les campagnes d'information du Planning familial, seules 6% des femmes prenaient la pilule. "Ici Paris" et "France Dimanche" la disaient alors dangereuse et inefficace. On baisait, en priant le ciel que ça n'arrive pas... Celles qui "tombaient" enceintes n'avaient qu'un choix : garder l'enfant ou braver la loi.
Les privilégiées partaient en Grande-Bretagne ou en Suisse, trouvaient dans leurs relations un médecin qui, moyennant finance, acceptait de faire le sale boulot. Les autres bricolaient, des aiguilles à tricoter, une sonde, des pastilles d'eau de Javel... Beaucoup y perdaient leur fécondité et, dans 1 cas sur 1.000, leur vie. Après des années de silence, l'opinion publique découvrait l'horreur des avortements clandestins grâce notamment aux féministes.
"Il se passe quelque chose dans mon ventre"
Personne ne pourrait aujourd'hui entendre ces filles qui hurlaient : "Il se passe quelque chose dans mon corps, une croissance, un processus biologique qui m'est intolérable. Je veux donc l'enlever de là... malheureusement, me dit-on, c'est un futur être humain, il appartient à la collectivité. Que la collectivité fasse des oeufs, qu'elle les féconde, qu'elle vomisse le matin..."
Il fallait bien ça pour lutter contre tous ces cathos, ces salauds, ces machos... En face, on ne faisait pas non plus dans la dentelle. A Assas, les militants de Laissez-les vivre ! faisaient monter une jeune handicapée sur une estrade et demandaient : "Alors tu n'es pas heureuse de vivre?" Une centaine de personnalités révoltées par le projet de loi Peyret (qui proposait de légaliser l'avortement dans certaines conditions, en cas de viol ou d'inceste, notamment) dénonçaient, à l'automne 1970, "cette tentative de légalisation du meurtre, premier pas dans la voie de l'extermination idéologique qui, après les bébés mal aimés, prendra pour cibles les infirmes et les impotents, les débiles mentaux et les clochards...".
Simone de Beauvoir : "Je vais vous aider"
"Sales connes, hurle Mafra, la complice d'Anne Zelensky, je vous dégueule dessus, tas de bourgeoises, vous, vous pouvez toujours vous payer un avortement!" Un petit groupe décide quand même de tester l'idée auprès de Simone de Beauvoir. L'icône du féminisme français les reçoit dans son duplex de la rue Schoelcher. Le Castor, avec ses petits yeux bleus, son chignon impeccable, va, comme toujours, droit au but : "Eh bien, je trouve l'idée très bonne. Et je vais vous aider."

Liste d’œuvres principales
Romans
1943 : L'Invitée1945 : Le Sang des autres
1946 : Tous les hommes sont mortels
1954 : Les Mandarins
1966 : Les Belles Images
1967 : La Femme rompue
1979 : Quand prime le spirituel
Essais
1944 : Pyrrhus et Cinéas, essai1947 : Pour une morale de l'ambiguïté, essai
1949 : Le Deuxième Sexe, essai philosophique
1955 : Privilèges, essai
1957 : La Longue Marche, essai
1970 : La Vieillesse, essai
1972 : Faut-il brûler Sade?, essai, reprise de Privilèges
Théâtre
1945 : Les Bouches inutiles, représentée aux Théâtre des Carrefours (actuellement Bouffes du Nord) en 1945 (première le 29 octobre), puis reprise en 1966 au Festival de Marvejols, et publiée chez Gallimard.Récits autobiographiques
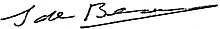
Signature de Simone de Beauvoir
1958 : Mémoires d'une jeune fille rangée
1960 : La Force de l'âge
1963 : La Force des choses
1964 : Une mort très douce
1972 : Tout compte fait
1981 : La Cérémonie des adieux suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre : août - septembre 1974
1962 : Djamila Boupacha en collaboration avec Gisèle Halimi et des témoignages de Henri Alleg, Mme Maurice Audin, Général de Bollardière, R.P. Chenu,Dr Jean Dalsace, J. Fonlupt-Esperaber, Françoise Mallet-Joris, Daniel Mayer, André Philip, J.F. Revel, Jules Roy, Françoise Sagan, un portrait original dePicasso et un hommage des peintres Lapoujade et Matta;
Sylvie Le Bon de Beauvoir, héritière de l'œuvre de Beauvoir, a traduit, annoté et publié de nombreux écrits de sa mère adoptive, en particulier sa correspondance avec Sartre, Bost et Algren.
Lettres à Sartre, tome I : 1930-1939, Paris, Gallimard, 1990.
Lettres à Sartre, tome II : 1940-1963, Paris, Gallimard, 1990.
Journal de guerre, septembre 1939-janvier 1941, 1990.
Lettres à Nelson Algren, traduction de l'anglais par Sylvie Le Bon, 1997.
Correspondance croisée avec Jacques-Laurent Bost, 2004.
Cahiers de jeunesse, 1926-1930, 2008.
Malentendu à Moscou (nouvelle), Paris, L'Herne, 2013, coll. "Carnets".
1960 : La Force de l'âge
1963 : La Force des choses
1964 : Une mort très douce
1972 : Tout compte fait
1981 : La Cérémonie des adieux suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre : août - septembre 1974
Autres publications
1948 : L'Amérique au jour le jour, récit1962 : Djamila Boupacha en collaboration avec Gisèle Halimi et des témoignages de Henri Alleg, Mme Maurice Audin, Général de Bollardière, R.P. Chenu,Dr Jean Dalsace, J. Fonlupt-Esperaber, Françoise Mallet-Joris, Daniel Mayer, André Philip, J.F. Revel, Jules Roy, Françoise Sagan, un portrait original dePicasso et un hommage des peintres Lapoujade et Matta;
Œuvres posthumes
Sylvie Le Bon de Beauvoir, héritière de l'œuvre de Beauvoir, a traduit, annoté et publié de nombreux écrits de sa mère adoptive, en particulier sa correspondance avec Sartre, Bost et Algren.
Lettres à Sartre, tome I : 1930-1939, Paris, Gallimard, 1990.
Lettres à Sartre, tome II : 1940-1963, Paris, Gallimard, 1990.
Journal de guerre, septembre 1939-janvier 1941, 1990.
Lettres à Nelson Algren, traduction de l'anglais par Sylvie Le Bon, 1997.
Correspondance croisée avec Jacques-Laurent Bost, 2004.
Cahiers de jeunesse, 1926-1930, 2008.
Malentendu à Moscou (nouvelle), Paris, L'Herne, 2013, coll. "Carnets".
Oeuvres de Simone de Beauvoir
La Liste de Titres
L'INVITÉE © Éditions Gallimard, 1943
PYRRHUS ET CINÉAS © Éditions Gallimard, 1944
LES BOUCHES INUTILES. Pièce en deux actes et huit tableaux © Éditions Gallimard, 1945
LE SANG DES AUTRES © Éditions Gallimard, 1945
TOUS LES HOMMES SONT MORTELS © Éditions Gallimard, 1946
POUR UNE MORALE DE L'AMBIGUÏTÉ © Éditions Gallimard, 1947
LE DEUXIÈME SEXE, TOME I © Éditions Gallimard, 1949
LE DEUXIÈME SEXE, TOME II © Éditions Gallimard, 1949
LES MANDARINS © Éditions Gallimard, 1954
L'AMÉRIQUE AU JOUR LE JOUR © Éditions Gallimard, 1954
PRIVILÈGES © Éditions Gallimard, 1955
LA LONGUE MARCHE. Essai sur la Chine © Éditions Gallimard, 1957
MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE RANGÉE © Éditions Gallimard, 1958
LA FORCE DE L'ÂGE © Éditions Gallimard, 1960
LA FORCE DES CHOSES © Éditions Gallimard, 1963
UNE MORT TRÈS DOUCE © Éditions Gallimard, 1964
LES BELLES IMAGES © Éditions Gallimard, 1966
LA FEMME ROMPUE - MONOLOGUE - L'ÂGE DE DISCRÉTION © Éditions Gallimard, 1967
LA VIEILLESSE © Éditions Gallimard, 1970
TOUT COMPTE FAIT © Éditions Gallimard, 1972
QUAND PRIME LE SPIRITUEL © Éditions Gallimard, 1979
LA CÉRÉMONIE DES ADIEUX suivi d'ENTRETIENS AVEC JEAN-PAUL SARTRE (AOÛT - SEPTEMBRE 1974) © Éditions Gallimard, 1981
JOURNAL DE GUERRE (Septembre 1939 - Janvier 1941) © Éditions Gallimard, 1990
LETTRES À SARTRE, TOME I © Éditions Gallimard, 1990
LETTRES À SARTRE, TOME II © Éditions Gallimard, 1990
LETTRES À NELSON ALGREN, OU QUAND PRIME LE SPIRITUEL © Éditions Gallimard, 1997
ANNE, OU QUAND PRIME LE SPIRITUEL © Éditions Gallimard, 2006
CAHIERS DE JEUNESSE (1926-1930) © Éditions Gallimard, 2008
L'EXISTENTIALISME ET LA SAGESSE DES NATIONS © Éditions Gallimard, 2008
Simone de Beauvoir et l'Amérique
Une « Grande Traversée » de France Culture est consacrée à celle dont la vie et l'oeuvre furent marquées par les États-Unis.
Quelque chose est en train d'arriver, on peut compter les minutes d'une vie où quelque chose arrive. Voilà. C'est arrivé, je vole vers New York.» Ces mots sont de Simone de Beauvoir, qui déboule en Amérique en 1947, à 39 ans. Beauvoir l'Américaine est aussi excitée qu'Alice au pays des merveilles, tandis qu'elle part à la découverte d'un New York mythique, éblouie par la beauté de « ses gigantesques dominos de pierre et de lumière». Elle veut tout voir, tout comprendre. Puis tout écrire, ce qu'elle fera dans L'Amérique au jour le jour, carnet de voyage vivant et engagé qu'il faut lire... Cette assoiffée d'absolu ne sait pas encore qu'elle va rencontrer l'amour avec un grand A.
Dans l'une de ces magnifiques «Grandes Traversées» radiophoniques dont France Culture a le secret, Christine Lecerf et Christine Diger mettent en avant la « Beauvoir transatlantique», son intérêt pour un pays «où va se jouer l'avenir du monde», sa passion éperdue pour l'écrivain Nelson Algren et l'enthousiasme, toujours vivant, que son oeuvre a suscité chez les intellectuels américains, au cours de cinq émissions d'une heure trente, diffusées tous les matins jusqu'au vendredi 21 août.
À travers cet épisode américain, les autres chapitres de sa vie - l'enfance et la rupture avec son milieu bourgeois, les années étudiantes et la rencontre, fondatrice, avec Sartre, la passion pour l'écriture, l'engagement féministe - largement explorés par les deux journalistes prennent une coloration différente. Seuls ses aveuglements envers les totalitarismes communistes ne sont qu'esquissés.
Christine Lecerf et Christine Niger construisent une symphonie de témoignages, de sons, de musiques et d'extraits choisis des écrits de Beauvoir. On est saisi d'émotion quand on se retrouve dans la chambre, à Chicago, où Beauvoir vécut sa passion avec Algren, l'écrivain doué des bas-fonds. On entend le cliquetis vrombissant du métro, on croit voir l'enseigne lumineuse qu'elle apercevait depuis le lit où les deux amants s'étreignaient. Dans cette relation physique passionnelle, très différente de la relation intense mais construite et intellectuelle qu'elle avait avec Sartre, Simone se réinvente. « Mon bien-aimé, mon mari», écrira-t-elle à Algren, dans une correspondance qui continue jusqu'en 1963.
Mais elle rentre à Paris, choisissant, après des années d'hésitation, Sartre et leur projet d'une union libre, plutôt que la passion et le mariage dont aurait rêvé Algren. Elle noiera ses larmes dans l'écriture du Deuxième Sexe, qui fait scandale en France mais va en faire l'inspiratrice du mouvement féministe, notamment américain.
De nombreuses femmes lui rendent hommage dans l'émission. Le témoignage d'Élisabeth Badinter est particulièrement intéressant. Le but de Beauvoir n'était pas d'être contre les hommes, c'était l'égalité, dit-elle.
Simone de Beauvoir et Le Féminisme
Figure du combat féministe

Armature idéologique du mouvement féministe, cet ouvrage et les idées défendues par Simone de Beauvoir marqueront le combat pour les femmes des années 1970. Prix Goncourt en 1954 pour Les Mandarins , la philosophe continuera jusqu'à sa mort, en 1986, à aborder les grands thèmes de société comme l'amour, la mort, l'euthanasie, en questionnant son propre vécu.
En 2008, le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes est créé en son honneur. Marque supplémentaire de sa présence dans la société contemporaine, le récent film Violette, de Martin Provost, s'attache à raconter la vie de Violette Leduc, amie proche de Beauvoir. Sandrine Kiberlain y interprète l'intellectuelle avec brio. En octobre, son nom est également apparu dans lespersonnalités féminines que les Français aimeraient voir entrer au Panthéon. Jeudi, c'est au tour de Google d'honorer la mémoire de cette intellectuelle hors-norme à travers un Doodle à son effigie.
Une actualité étonnante, bien loin des livres philosophiques. Comme de nombreux penseurs, sa personnalité a autant marqué que son œuvre. Une postérité qui traduit malgré tout l'importance de l'héritage qu'elle a laissé. Une pensée dont les questionnements - c'est sans doute le propre des intellectuels marquants - occupent encore aujourd'hui la société. En premier lieu, l'enjeu de la place des femmes, et de la réappropriation de leur individualité. La récente nomination de Jane Campion à la tête du Festival de Cannes rappelle que ce combat, loin d'être achevé, se poursuit à travers d'autres personnalités.
Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre
Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, un couple mythique de la littérature
Ils vivaient d'amour et de littérature : Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre formaient l'un des couples mythiques et anticonformistes du XXe siècle.
La romancière et le philosophe ont partagé leurs vies, leurs idées et leurs combats, s’inspirant mutuellement et collaborant de manière fructueuse. Ils ont notamment voyagé dans le monde entier, surtout dans les pays communistes où ils ont notamment rencontré Mao ou Fidel Castro.
Jamais mariés
Jamais mariés
Mais la liberté reste le maître-mot de ce couple étonnant qui va multiplier les aventures sans les cacher à l'autre. Simone de Beauvoir a ainsi vécu plusieurs relations homosexuelles et une relation passionnée avec l'écrivain américain Nelson Algren pendant 15 ans.
"Sartre ne peut se concevoir sans Beauvoir, ni Beauvoir sans Sartre", a cependant déclaré Jean-Paul Sartre qui a multiplié de son côté les aventures amoureuses. Dans son roman L'Invitée(1943) largement autobiographique, Simone de Beauvoir raconte le ménage à trois que Sartre et Beauvoir ont vécu avec Olga Kosakiewitcz.
La publication de leur correspondance (Lettres au Castor en 1983 et Lettres à Sartre en 1990) a encore éclairé le couple sous un autre jour, choquant de nombreux admirateurs de leurs combats et de la liberté assumée de leur relation. Le couple ne s'est jamais marié. Sartre est mort en 1980, Simone de Beauvoir en 1986. Ils sont inhumés côte à côte au cimetière du Montparnasse à Paris.
"Sartre ne peut se concevoir sans Beauvoir, ni Beauvoir sans Sartre", a cependant déclaré Jean-Paul Sartre qui a multiplié de son côté les aventures amoureuses. Dans son roman L'Invitée(1943) largement autobiographique, Simone de Beauvoir raconte le ménage à trois que Sartre et Beauvoir ont vécu avec Olga Kosakiewitcz.
La publication de leur correspondance (Lettres au Castor en 1983 et Lettres à Sartre en 1990) a encore éclairé le couple sous un autre jour, choquant de nombreux admirateurs de leurs combats et de la liberté assumée de leur relation. Le couple ne s'est jamais marié. Sartre est mort en 1980, Simone de Beauvoir en 1986. Ils sont inhumés côte à côte au cimetière du Montparnasse à Paris.
Simone de Beauvoir - Biographie complète
Née à Paris (France) le 09/01/1908 ; Morte à Paris (France) le 14/04/1986
Femme de lettres française, Simone de Beauvoir est reconnue dans le monde entier grâce à son essai féministe intitulé le Deuxième sexe. Sa relation amoureuse et particulièrement marginale pour l’époque avec le philosophe et écrivain Jean-Paul Sartre lui confère un statut particulier de femme indépendante et totalement libérée.
Le rejet d’un enseignement religieux
Simone Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir vient au monde le 9 janvier 1908, au sein d’une famille catholique relativement aisée. Aînée d’une famille de deux enfants, elle reçoit une éducation maternelle sévère et traditionnelle. Enfant, elle étudie à l’Institut Désir, une école catholique. Elle rejette très tôt ces enseignements en se déclarant totalement athée.
Elle se découvre alors une profonde passion pour la lecture et l’écriture. Dès 1926, elle s’inscrit à des cours de philosophie dispensés à la Sorbonne. Elle obtiendra l’agrégation trois ans plus tard avec un résultat plus que satisfaisant. Elle enseignera sa discipline à Marseille, puis à Rouen et à Paris. Toutefois, non comblée par cette profession, elle l’abandonne en 1943 pour suivre une carrière littéraire. Son premier roman, l’Invitée, met en scène des rapports amoureux embrasés par le sentiment de jalousie, au sein d’une relation tripartite.
Disciple et compagne de Jean-Paul Sartre
En 1929, sa rencontre avec l’existentialiste Jean-Paul Sartre marque un tournant décisif dans son existence et dans sa conception de la vie. Tous deux nouent une relation intellectuelle et affective très forte mais ne se conforment pas à la vie maritale. Ils se refusent en effet à partager le même toit.
Jusqu’à la mort du philosophe, ils vivront ainsi dans l’anticonformisme le plus total. Les liaisons extérieures font partie intégrante de leur relation, qui va parfois jusqu’à inclure une tierce personne dans leur jeu amoureux. Le rapport que Simone de Beauvoir entretient avec son amant illustre parfaitement ses réflexions sur la position de la femme au sein de la société et sur le rapport à l’autre en général.
Un écrivain particulièrement engagé
Les idées qui fleurissent dans l’esprit de Simone de Beauvoir sont marquées très tôt par un fort engagement politique. Dès 1926, elle intègre un mouvement socialiste. En 1945, Jean-Paul Sartre crée les Temps modernes, une revue de gauche dans laquelle elle écrira de nombreux articles. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, ses engagements politiques redoubleront d’intensité.
Elle fait preuve également d’un engagement très prononcé envers la condition féminine. En 1949, elle publie un essai intitulé le Deuxième sexe. Dans des considérations toujours proches de l’existentialisme, elle prône la libération et l’émancipation de la femme dans la société. À travers une étude historique, scientifique, sociologique et littéraire, elle tente de démontrer à quel point la femme est aliénée par l’homme. L’unique moyen de s’y soustraire serait alors d’acquérir une indépendance totale. Cet ouvrage scandalise la haute société mais sera soutenu par Lévi-Strauss et deviendra le socle des premiers mouvements féministes.
Une culture du voyage
Dès 1947, Simone de Beauvoir se lance à la découverte du monde. Elle se rend tout d’abord aux Etats-Unis, où elle rencontrera son amant Nelson Algren, puis parcourt l’Afrique et l’Europe. En 1955, elle débarque en Chine. Elle découvre Cuba et le Brésil au début des années 1960, puis séjourne en URSS. Ses différents périples à l’étranger lui permettent d’enrichir ses ouvrages, qu’elle ne néglige à aucun moment.
En 1954, son roman les Mandarins remporte le prix Goncourt. Elle abandonne toutefois le genre romanesque pour se consacrer aux essais et aux ouvrages autobiographiques. En 1958 paraît Mémoires d’une jeune fille rangée, suivi de la Force de l’âge et de la Force des choses. À travers cette fresque autobiographique, elle propose un exemple d’émancipation féminine et poursuit son étude sur le comportement et la responsabilité des hommes au sein de la société.
Une perte qui la tue à petit feu
En 1980, Jean-Paul Sartre décède. Simone de Beauvoir est particulièrement affectée par cette perte, qu’elle considère avec fatalisme. Elle s’éteint en 1986, à l’âge de 78 ans et reposera au cimetière Montparnasse, à Paris.
Écrivain et essayiste, disciple du mouvement existentialiste, Simone de Beauvoir est considérée comme le précurseur du mouvement féministe français. Son œuvre fut grandement influencée, et illustrée par sa relation anticonformiste avec le philosophe Jean-Paul Sartre.
Simone de Beauvoir - Origines
Née il y a plus d'un siècle, elle reste au cœur des débats modernes. La personnalité de Simone de Beauvoir, auteure française née le 9 janvier 1908, est intimement liée à celle d'un autre penseur existentialiste du XXe siècle, Jean-Paul Sartre. Il est souvent difficile de dissocier l'une de l'autre. Les écrits de cette femme de lettres restent néanmoins une référence philosophique, souvent controversée, à l'heure de débats sur la théorie du genre et l'égalité entre hommes et femmes.
Cette Parisienne tombe très jeune dans l'écriture. Après avoir étudié les lettres et les mathématiques, la jeune Simone de Beauvoir s'intéresse à la philosophie. Agrégée dans cette matière en 1929, elle devient enseignante. Élevée de manière très pieuse dans sa famille, mais devenue athée très jeune, elle s'oppose fermement au mariage et développe sa pensée autour de la liberté et de l'autonomie des individus, plus particulièrement des femmes. Elle collabore avec d'autres intellectuels et artistes marquants du XXe siècle, dont Boris Vian, Maurice Merleau-Pontyet bien sûr Jean-Paul Sartre, à la revue Les Temps modernes, qu'elle a contribué à fonder. Ce qui ne l'empêche pas de travailler à sa propre œuvre littéraire et philosophique.
En 1949, elle publie son ouvrage le plus célèbre, Le Deuxième Sexe . Le livre, succès des ventes, avance des thèses très avant-gardistes pour l'époque et lui apporte à la fois le succès et, pour une plus grande part, la condamnation par certains. Simone de Beauvoir y évoque la condition féminine, les situations de domination de la femme, le tabou de l'avortement, considéré comme un crime à l'époque. Elle y défend l'idée que le rapport entre hommes et femmes est une construction sociale. Symbole de cette thèse, la phrase extraite de cet ouvrage désormais associée à Beauvoir: «On ne naît pas femme, on le devient.»
Rélative au Féminisme XIXe siècle
Monarchie de Juillet
Éteintes sous l’Empire et la Restauration, les revendications féministes renaissent en France avec la Révolution de 1830. Un féminisme militant se développe à nouveau dans les milieux socialistes de la génération romantique, en particulier chez les saint-simoniens et les fouriéristes de la capitale. Les féministes participent à l'abondante littérature de l'époque, favorisée par la levée de la censure sur la presse. La Femme Libre et La Tribune des femmes paraissent en 1832 ; Le Conseiller des femmes, édité à Lyon par Eugénie Niboyet, est le premier journal féministe de province.
Sur le plan politique, la constitution de la Monarchie de Juillet privant de ses droits la majorité de la population française, le combat des femmes rejoint celui des premiers défenseurs des ouvriers et des prolétaires, mais les femmes se mobilisent également contre le statut civil de la femme, soumise en matière juridique et financière à son mari — « La femme doit obéissance à son mari » affirme le Code civil —, et pour le rétablissement du divorce interdit sous la Restauration en 1816.
Certaines femmes revendiquent le droit à l’amour libre, au scandale de l'opinion publique. Claire Démar se livre ainsi dans son Appel au peuple sur l'affranchissement de la femme (1833) à une critique radicale du mariage dans lequel elle dénonce une forme de prostitution légale. Elle n’est toutefois pas suivie par l’ensemble des saint-simoniennes qui tiennent à se démarquer des accusations d’immoralisme qui frappent le mouvement5.
Les débuts du régime laissent entrevoir quelques espoirs d’évolution. Les pétitions en faveur du rétablissement du divorce placent ce sujet sur l’agenda politique : en 1831 et 1833, les députés votent par deux fois en faveur de la loi, laquelle est toutefois repoussée par la Chambre des pairs6. Les revendications féministes deviennent inaudibles. Quand Louise Dauriat adresse en 1837 aux députés une demande en révision des articles du Code civil qui lui paraissent contraires aux droits des femmes, elle ne récolte en retour que les rires de l’assemblée.
Naissance du Féminisme
Révolution française et droit des femmes
Malgré les contributions féminines à la rédaction des cahiers de doléances et le rôle que jouent les femmes du peuple parisien —notamment lors des manifestations d’octobre 1789 pour demander du pain et des armes —, les femmes ne se voient pas attribuer de droit particulier dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; et si le nouveau régime leur reconnaît une personnalité civile, elles n'auront pas le droit de vote à cette époque.
Elles n'en continuent pas moins à investir l'espace public, organisées en clubs mixtes ou féminins et en sociétés d’entraide et de bienfaisance, et participent avec passion — à l'instar des hommes — à toutes les luttes politiques de l'époque. Parmi les personnalités féminines notoires des débuts de la Révolution, il faut retenir Olympe de Gouges qui publie en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et Théroigne de Méricourt qui appela le peuple à prendre les armes, et participant à la prise de la Bastille, ce dont elle sera récompensée par le don d'une épée par l'Assemblée nationale. C’est par des femmes comme Claire Lacombe, Louison Chabry ou Renée Audou que fut organisée la marche sur Versailles qui finit par ramener Louis XVI dans la capitale.
Toutes deux proches des Girondins, elles connurent une fin tragique : Théroigne de Méricourt devenant folle après avoir été fouettée nue par des partisanes de leurs adversaires, Olympe de Gouges guillotinée. Si les femmes ont été privées du droit de vote, cela ne les a pas préservées des châtiments réservés aux hommes, et nombreuses connurent la prison ou l'échafaud à la suite de leurs actions publiques ou politiques.
À partir de 1792, l'entrée en guerre de la France conduit certaines à se battre aux frontières, tandis qu'en 1793 se développe à Paris un militantisme féminin, porté par des femmes du peuple parisien proches des sans-culotte. Les deux cents femmes du Club des citoyennes républicaines révolutionnaires créé le 10 mai 1793 par Claire Lacombe et Pauline Léon, les « tricoteuses », occupent les tribunes publiques de la Constituante et apostrophent les députés, entendant représenter le peuple souverain. Claire Lacombe propose d’armer les femmes. Leurs appels véhéments à la Terreur et à l'égalité, leur participation à la chute des Girondins, ainsi que les autres manifestations spectaculaires des « enragées », allaient leur valoir une image de furies sanguinaires qui entretiendrait longtemps les répulsions du pouvoir masculin.
Cependant, plus que les excès d'une violence largement partagée à l'époque, ce sont d'abord les réticences des hommes au pouvoir qui excluent les femmes de la sphère politique. La plupart des députés partagent les conceptions exposées dans Émile, ou De l'éducation de Rousseau d'un idéal féminin restreint au rôle de mères et d'épouses, rares étant ceux qui, comme Condorcet, revendiquent le droit de vote des femmes en vertu des droits naturels inhérents au genre humain, lesquels, à la même époque, inspirent la lutte contre le despotisme et l’esclavage.
En novembre 1793, toute association politique féminine est interdite par la Convention, un seul député s'y oppose Louis Joseph Charlier, mais les femmes vont continuer à jouer un rôle jusqu'à l’insurrection du printemps 95, dont le mot d’ordre est « du pain et la Constitution de 93 », avant que la répression généralisée qui marque la fin de la Révolution ne mette un terme provisoire à cette première prise de parole politique, pour les femmes comme pour les hommes.
Échos en Grande-Bretagne
En 1792, une femme de lettres britannique, Mary Wollstonecraft fait paraître « Vindication of the Rights of Woman », un ouvrage traduit en français la même année sous le titre de « Défense du droit des femmes ». L'auteure, qui participe aux débats passionnés suscités outre-Manche par la Révolution en France, n'hésite pas à assimiler le mariage à la prostitution. Elle oppose et rapproche l'exploitation dont sont victimes les femmes les plus pauvres, contraintes au travail salarié ou à la rémunération de leurs services sexuels, au sort des jeunes femmes de la petite et moyenne bourgeoisie privées de toutes perspectives professionnelles par les préjugés et le défaut d'éducation, et réduites à faire un beau parti.
Mary Wollstonecraft sera vite oubliée en France, avant d'être redécouverte par Flora Tristan en 1840.
Multiplication des courants littéraires (1945-1960)
La Guerre Froide et la menace atomique provoquent inquiétude et désillusion, redistribution des valeurs, production éclectique, peu renouvelée.
| 1942 | F. Ponge | Le parti-pris des choses |
| 1947 | B. Vian | L'écume des jours |
| J. Genet | Les Bonnes | |
| R. Queneau | Exercices de style | |
| 1948 | H. Bazin | Vipère au poing |
| J. Prévert | Paroles | |
| 1949 | S. de Beauvoir | Le deuxième sexe |
| 1950 | E. Ionesco | La cantatrice chauve, le Roi se meurt |
| 1953 | S. Beckett | En attendant Godot |
| 1957 | M. Butor | La Modification |
| A. Robbe-Grillet | La Jalousie |
Certaines innovations sont intégrées
- surréalisme (Prévert, Vian)
- engagement politique (Sartre, Malraux, De Gaulle, R.Vaillant)
- retour aux valeurs traditionnelles "Nouveau classicisme" (Gide, Bernanos, Aragon, Eluard, Giono, Césaire, Senghor).
Existentialisme : système philosophique qui trouve son origine chez le philosophe danois Kierkegaard (1813-1855) et le philosophe allemand Heidegger (1889-1976). En France, le terme prévaut dans les années 1945 et trouve une expression privilégiée dans les œuvres littéraires de Sartre et Camus. L'idée fondamentale de cette philosophie est que l'homme ne se définit que par la somme de ses actes et ne trouve son identité qu'à travers son existence. Aucune divinité ne donnera de sens à sa vie. Jeté dans un monde absurde, il découvre avec angoisse qu'il est responsable de ce qu'il fait; il est "condamné à être libre" et à se choisir à tous les instants.Absurde : sentiment que notre existence et la marche du monde n'ont pas de sens. Notion présente essentiellement dans la littérature des années 1940-1950.
Culture de masse (1918-1960)
La culture est désormais produite en masse et consommée par les masses mais non créées par elles et elle ne vise pas à leur émancipation éthique ou politique.
De 1918 à 1940
L'accès à la culture se fait par la presse à grand tirage, le music-hall, le cinéma parlant (1928), la radio prennent de plus en plus d'importance au détriment de l'école et de la lecture. Quelques vedettes sont très populaires : Fernandel, Gabin, Piaf, Mistinguett, M. Chevalier, T. Rossi, Carné, Renoir.Au théâtre du boulevard, on applaudit Sacha Guitry. La comédie de moeurs est illustrée par M. Pagnol maître de l'exotisme provincial. La bande dessinée américaine se répand à côté des productions européennes : Tintin, les Pieds Nickelés, Bibi Fricotin, Bécassine.
De 1940 à 1960
Les médias se développent de façon extraordinaire (disque microsillon) la culture s'américanise : jazz, comics, western, polars, espionnage, "Série Noire" (1945), A. Christie.La production française est assurée par : Trenet, Mouloudji, Montand, Prévert, Brassens, Simenon. La presse du coeur se développe : roman-photo (Del Duca, Nous Deux). En BD où la censure est très active, Spirou (Franquin, Morris, Goscinny), Pif, Pilote...
L'aspect socio - politique de l'époque
L'origine sociale compte désormais moins que l'appartenance politique. Le texte est mis au service d'une idéologie. Certains tentent de créer une "littérature prolétarienne" (C. Malva).
J. Vilar veut ouvrir le théâtre au public populaire (1951 : T. N. P.). Continuateur du théâtre de tradition, J. Anouilh développe le thème de la pureté juvénile se heurtant au néant et à la corruption.
Il s'agit de la dernière génération d'écrivains maîtres à penser. En écriture, réalisme et conception marxiste du style (R. Barthes) : la préoccupation esthétique est taxée de "bourgeoisie". Succès de l'existentialisme
Le genre dominant est le roman à thèse (Sartre, Malraux).
Engagement : à partir des années 1930, l'écrivain ne conçoit pas de rester indifférent aux événements de son temps; il se doit de prendre des positions politiques ou idéologiques. Sartre met à l'honneur le terme, estimant qu'aucune écriture ne peut être innocente : l'écrivain "sait que les mots, comme dit Brice Parain, sont des pistolets chargés". (Qu'est-ce que la littérature ?, 1947). Il ajoute que tout homme, qu'il le veuille ou non, se trouve engagé, car ne pas choisir est encore une manière de choisir. POTELET
XXe siècle
La Littérature du XXe siècle donne l'impression d'être abondante et inclassable. Cette complexité vient certes du nombre de livres édités, mais surtout des bouleversements historiques et sociologiques qui ont marqué le siècle et posé des questions auxquelles aucune réponse univoque n'a été donnée.
Modification des liens entre l'auteur et le public.
Le renouvellement est assuré par des groupes restreints, les "avant-gardes" coupées du grand public. Cela ne doit pas faire illusion, la plupart des auteurs continuent à écrire selon l'esthétique du roman réaliste du XIXe siècle.
On peut supposer que tous les Français sont un public potentiel mais ce public n'est plus homogène: l'impression d'abondance que donne la littérature n'est donc que la multiplication du nombre des auteurs destinés à satisfaire les goûts de ce public diversifié, et non le symptôme d'une richesse d'invention. Ce qui s'accroît surtout, c'est une littérature de divertissement pour un public de culture moyenne, littérature dont l'importance sociologique est peut-être plus grande que les préoccupations esthétiques.
La littérature est de plus en plus un commerce. La pauvreté créatrice est souvent dissimulée par la fabrication d'"événements littéraires": publicité, vedettariat, multiplication des Prix, exploitation rapide des succès, etc.
Culture et littérature en question
La notion de culture apparaît comme relative aux goûts et aux définitions de la classe dominante qui tend à en faire un dogme figé; l'enseignement la propage comme une vérité immuable (tradition, inutilité, humanisme), alors que le monde social évolue et manifeste des goûts et des désirs différents. L'écrivain prend une conscience plus aiguë de son isolement et de sa compromission avec la société bourgeoise, il devra choisir une attitude:
- écrire ce qui se vend;
- écrire pour écrire, réfléchir sur soi et sur l'acte d'écrire;
- écrire pour changer le monde : s'engager;
- contester la place et la fonction de la culture au profit d'une culture authentiquement populaire.
La littérature, elle aussi, est l'objet d'une profonde interrogation pour plusieurs raisons:
Les novateurs qui influencent la littérature française sont étrangers (Kafka, Joyce, Faulkner, Brecht)
On réfléchit sur l'héritage littéraire, cela donne lieu à des relectures, des réécritures. Redécouvertes passionnantes qui font éclater les critères selon lesquels une oeuvre était dite "bonne" ou "mauvaise", mais si amples que ce sont les normes et la définition même du littéraire qui sont remises en cause, et qui présentent le danger parfois de confondre les curiosités avec ce qui a vraiment une importance historique ou esthétique.
En marge de la littérature "officielle" se développe une para-littérature (roman policier, bande dessinée,...) et des moyens d'expression nouveaux (cinéma, radio, télévision, disques...)
Il est désormais matériellement impossible de citer tous les auteurs et il est très difficile de leur trouver assez de points communs justifiant qu'on les réunisse sans quelque arbitraire. La difficulté s'accroît d'ailleurs du fait que les historiens sont trop proches de ces phénomènes culturels et littéraires, pour en dégager avec certitude l'importance réelle.
Le goût pour la littérature (1914-1940)
La société française est bouleversée en profondeur par la guerre de 1914-18. Mais les tendances du XIXe siècle continuent à marquer un grand nombre d'oeuvres. Beaucoup d'écrivains en effet, ne sont séduits ni par les expériences d'avant-garde, ni par l'engagement politique explicite. Ils ne forment pas une école ou un mouvement précis, mais à travers la diversité de leurs attitudes, quelques préoccupations communes les unissent solidement. Tous tombent d'accord pour affirmer la grandeur de la création littéraire. Tous font aussi de la psychologie du sujet le centre de leur analyse. Cette célébration de la littérature et de l'individu est en fait une défense contre un sentiment de malaise, plus ou moins avoué, dans une société où la guerre et ses suites font naître des interrogations multiples. A partir des années '30, la plupart de ces écrivains devront opter pour une attitude socio-politique explicite, ou se cantonner dans un refus hautain de s'engager.
| 1913 | Alain-Fournier | Le Grand Meaulnes |
| 1913-27 | M. Proust | A la recherche du temps perdu |
| 1922 | P. Valéry | Charmes |
| 1924 | P. Claudel | Le Soulier de satin |
| 1925 | A. Gide | Les Faux-monnayeurs |
| 1927 | F. Mauriac | Thérèse Desqueyroux |
| 1930 | Colette | Sido |
| 1930 | J. Giono | Regain |
| 1932-46 | J. Romains | Les Hommes de bonne volonté |
| 1934 | M. Aymé | Contes du Chat perché |
| 1935 | J. Giraudoux | La Guerre de Troie n'aura pas lieu |
| 1936 | G. Bernanos | Journal d'un curé de campagne |
| H. De Montherlant | La Reine Morte | |
| 1938 | J.-P. Sartre | La Nausée |
| 1939 | A. de Saint-Exupéry | Terre des hommes |
| 1942 | A. Camus | L'Etranger |
Les courants littéraires
Un courant littéraire (aussi appelé mouvement littéraire) regroupe des principes, des idées et une vision commune de la littérature.
Les auteurs faisant partie d’un même courant littéraire partagent souvent une même vision esthétique de l’écriture. L'œuvre d'un auteur peut donc ressembler, d’une certaine manière, à celle d'un autre (tout en préservant des traits spécifiques au style de l’auteur).
Un courant peut découler d'un autre, mais de manière générale, un courant naît en opposition à un autre qui le précède. De plus, ils n'apparaissent pas dans un seul pays ou une seule région. Souvent, ils se répandent sur un continent ou sur plusieurs. La plupart du temps, un courant traverse tous les arts à la fois.
L’existentialisme
L’existentialisme, en tant que courant, se présente avant tout comme une manière de philosopher. La philosophie a pour but essentiel d’exposer l’homme à lui-même, de telle sorte qu’il s’y reconnaissance authentiquement. Mais il existe deux types de philosophies :
– celles qui tentent de mettre au jour la structure générale de l’existence, via l’étude de concepts tels que Dieu, l’être ou le monde. Ils prennent l’homme comme le point de fermeture d’un système (mouvement descendant)
– celles qui partent de la subjectivité pour comprendre les autres concepts, tels que Dieu, l’être ou le monde (mouvement ascendant)
L’existentialisme appartient à la seconde catégorie. L’existentialisme cherche en effet à résoudre l’énigme qu’est l’homme pour lui-même.
Figure de proue du courant de pensée existentialiste, Jean-Paul Sartre a fourni un effort considérable en vue de définir précisément son concept fondateur. Dans un premier temps, la pensée sartrienne s’est définie en s’opposant aux deux grands courants traditionnels, soit le matérialisme et l’idéalisme. En s’inspirant tout d’abord de la phénoménologie puis du marxisme, Sartre a développé une pensée réaliste.
Dans l’opuscule L’existentialisme est un humanisme, Sartre déclare que pour la pensée existentialiste toute vérité et toute action impliquent un milieu humain et une subjectivité humaine. Cela veut dire que tous les aspects de cette doctrine se rapportent à l’être humain et à sa faculté de prendre conscience de sa situation.
L’en-soi et le pour-soi
On trouve le premier fondement original de l’existentialisme sartrien dans la distinction entre l’être en-soi et l’être pour-soi. Ainsi, l’en-soi et le pour-soi s’opposent.
L’en-soi est la caractéristique de toute chose, de toute réalité extérieure à la conscience. Le concept d’en-soi désigne ce qui est totalement soumis à la contingence, c’est-à-dire tout ce qui est sans liberté et ce qui n’entretient aucun rapport à soi. L’existence de tout en-soi est passive en ce sens que, par exemple, un vélo ne peut décider d’être autre chose qu’un vélo. Un sapin n’exige jamais de son jardinier préféré une taille en forme d'ourson parce qu'il deviendrait sentimental. Sans conscience, le sapin demeure toujours égal à lui-même. Ce concept d’en-soi se rapporte donc aux choses matérielles parce qu’elles existent indépendamment de toute conscience.
L’existence précède l’essence
La formule sartrienne la plus célèbre qui permet de définir ce courant de pensée est sans doute : L'existence précède l'essence.
En ce qui concerne l’en-soi, la chose peut correspondre à un schéma, à un plan, à un concept. On parle alors de l’essence de cette chose. Ainsi, l’essence du vélo correspond à l’idée générale qu’on a tous de cet objet, indépendamment de sa couleur, de sa grosseur, etc. On dit alors que l'essence (ou encore l'idée, le plan, le concept ...) précède l'existence. Si Jean-Paul Sartre peut admettre une telle explication pour tous les objets, il prétend qu’une telle façon de faire ne peut rendre compte de ce qu’est l’être humain.
L’athéisme
L’existentialisme sartrien est athée. Cela signifie qu’au point de départ on trouve la conviction que Dieu n’existe pas. Sartre tente de tirer toutes les conclusions que cette idée entraîne. En conséquence, nulle divinité n'a pu créer l'humain. Aucune force suprême ne peut nous sauver du mal, de la souffrance, de l’exploitation, de l’aliénation ou de la destruction. Aucun Au-delà non plus pour justifier quelque bien ou quelque vérité que ce soit. Totalement délaissé, l’être humain est absolument responsable de son sort. Ainsi, chaque choix que j’accomplis m’appartient en propre. Ultimement, puisqu’il n’y a aucun dieu, notre existence se déroule en une succession de libres choix qui ne sont jamais entièrement justifiables.
Philosophie de l’action et de l’engagement, l’existentialisme sartrien ramène tout à l’être humain, le rendant absolument responsable de son sort. Acculé à l’action, il doit s’engager dans son existence, prendre en main le cours de sa vie.
Le Dadaïsme et Le Surréalisme
Histoire du dadaïsme
Au coeur de la Première Guerre mondiale, l'ambiance est acariâtre.
La grande boucherie s'approprie des milliers de combattants, laissant ainsi les familles en deuil et les coeurs meurtris. L'Europe n'a jamais été plus sombre et déchirée.
C'est en février 1916, à Zurich, qu'un ensemble de révolutionnaires s'emploi à faire tourner le vent. Le metteur en scène Hugo Ball ainsi que sa compagne Emmy Hennings qui est danseuse, poétesse et écrivain, arrivent dans la ville suisse et décident de former ensemble le Cabaret Voltaire, véritable plaque tournante dadaïste.
Le Cabaret Voltaire a pour mission de divertir ses adeptes en présentant des programmes musicaux et poétiques exécutés par des artistes présents parmi le public.
De plus, les créateurs du Cabaret incitent les jeunes artistes de Zurich à participer à la programmation en donnant leurs suggestions. C'est ainsi qu'on attire les grands personnages dudadaïsme: Tristan Tzara, poète roumain, Richard Huelsenbeck, poète allemand, Jean Arp, sculpteur alsacien ainsi que Hans Richter, peintre allemand.
C'est en ouvrant au hasard un dictionnaire qu'ils tombent sur le mot « Dada »
et qu'ils décident de nommer leur mouvement de la sorte.
Le mot « Dada » n'a absolument aucune signification particulière en rapport avec le mouvement, ce dernier se voulant un pied de nez à la guerre et sa gravité, jugées absurdes.
Le groupe d'artistes anticonformistes entend briser, par le biais du dadaïsme, les conventions imposées dans l'art et la littérature en vouant un culte à la liberté de création sous toutes ses formes. Le mouvement s'impose sans véritable tête dirigeante, tous les Dadas étant chef de file.
C'est en 1918 que le dadaïsme culmine. Le peintre et sculpteur Marcel Duchamp se joint au groupe zurichois, et donne un impact non négligeable au mouvement.
Le mot « surréalisme » a été choisi en hommage à Apollinaire. Celui-ci venait en effet de mourir (1918) et avait signé peu auparavant avecLes Mamelles de Tirésiasun « drame surréaliste ». C'est dans son premierManifesteque Breton en propose la définition :Surréalisme, n. m. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.
En fait, le surréalisme dépasse très largement cette définition de l'écriture automatique, Breton ayant pris grand soin de le distinguer d'une école littéraire. C'est dans la vie que le surréalisme devait trouver son territoire en promouvant unnouveau regardsur les objets et sur les mots, qu'il a débarrassés de leur utilitarisme. Veillant à ne laisser échapper aucune association mentale digne de contribuer à la libération de l'esprit, il a fourni aussi le modèle durable d'uneinsurrection généralecontre tous les mots d'ordre de la société bourgeoise. Profondément marqué enfin par la personnalité d'André Breton, le surréalisme est indissociable d'une morale dont les impératifs catégoriques -la poésie, l'amour, la liberté- ont été haut tenus, malgré les vicissitudes du groupe et les tentatives de réduction.
AndréBreton(1896-1966)
Manifeste du surréalisme(1924)
Aux écoutes d'une « voix intérieure » qui leur dicteLes Champs magnétiques(1919), Breton et Soupault élaborent une poétique radicalement nouvelle, bâtie sur le caractère impérieux et gratuit d'un automatisme verbo-auditif. Revenant, dans son premierManifeste,sur l'expérience, Breton ne doute pas d'avoir trouvé là la matière première de l'inspiration poétique et il assignera pour tâche au surréalisme l'exploration de l'inconscient, terreau de ce matériau inouï.
Le surréalisme essaye de libérer l’écriture de la raison, d’où les procédés comme l’écriture automatique, l’association libre (empruntée à Freud), les cadavres exquis, etc.
Mouvement révolutionnaire non violent
Œuvre fondatrice : le Manifeste du surréalisme d’André Breton
domingo, 22 de noviembre de 2015
XX siècle
Le vingtième siècle est une période très mouvementée, qui a vu de nombreux conflits et où les découvertes scientifiques se sont succédé à un rythme de plus en plus rapide.
Ce qui a surtout marqué le siècle, c’est l’accession de la femme au marché du travail et au droit de vote, phénomène dû en grande partie à la Deuxième Guerre mondiale.
Avant la première guèrre mondiale
La France vit alors une période de grande prospérité sur tous les plans : socioéconomique, politique, etc.
expansion de l’instruction, qui est valorisée
extension des droits des travailleurs (syndicats, diminution des heures de travail, ins-tauration d’un salaire minimum, etc.)
Loi Combes (1905)
séparation définitive de l’Église et de l’État dissolution des congrégations religieuses (et, bien sûr, confiscation de leurs biens)
La Grande Guerre est causée par un jeu complexe d’alliances, un impérialisme exacerbé et un sentiment de menace éprouvé par chacun des peuples qui y a participé
Imminente, elle est provoquée, entre autres, par l’assassinat de François-Ferdinand (en juin), héritier du trône de Vienne, et celui de Jean Jaurès (en juillet), soutenant une solution pacifiste
En se déclarant la guerre, les peuples d’Europe pouvaient trouver toutes les justifications possibles en se présentant comme des victimes protégeant leur honneur, leurs droits, leurs frontières...
XIX siècle
Période très mouvementée
L'Empire (1804-1815)
La Restauration (1815-1830)
La monarchie de Juillet (1830-1848)
La Deuxième République (1848-1851)
Le Second Empire (1852-1870)
La Troisième République (1870-1940)
Le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, s’est terminé dans un grand bain de sang. Les Français, mécontents du gouvernement de Louis XVI qui les écrase de taxes mais exempte d’impôts la noblesse, se révoltent. Le 14 juillet 1789, des insurgés, aidés de soldats du roi, s’emparent de la Bastille, prison stratégique de Paris, ce qui encourage la population à se rebeller. C’est bientôt tout le pays qui fait la révolution. En 1793, le roi, symbole suprême d’un ancien ordre des choses, est exécuté. On guillotine aussi la reine et des milliers de nobles, ainsi que tous ceux que l’on soupçonne d’être contre la Révolution. Cette période sanglante sera baptisée la Terreur.
À la suite de cet épisode, les révolutionnaires promettent aux autres nations de les aider à se libérer de la monarchie elles aussi. C’est ainsi que la France commence à envahir les pays voisins. Afin de se protéger, l’Angleterre et l’Autriche attaquent la France en 1793. La France sortira vainqueure de cette guerre de deux ans.
Le romantisme est une nouvelle sensibilité, s'opposant au Classicisme, aux Lumières et à la rationalité. Elle proclame le culte du moi, l'expression des sentiments jusqu'aux passions. « Issu de bouleversements politiques et sociaux sans précédent, il met l'homme et l'artiste devant un destin, improbable, inquiétant. Cette vision dramatique de l'humanité est alors commune à tous les arts, même au théâtre et à l'opéra, sous la magnificence des décors… Le réel, que les romantiques rendent expressif, dramatique, l'emporte sur le beau idéal9. » Neuve et subversive, cette sensibilité se manifeste dans la littérature et les arts plastiques par un renouvellement thématique, le Moyen Âge10, l'Orient, l'époque napoléonienne, la littérature étrangère.
Le Réalisme est un mouvement artistique et littéraire apparu en France vers 18501, né du besoin de réagir contre le sentimentalisme romantique. Il est caractérisé par une attitude de l’artiste face au réel, qui vise à représenter le plus fidèlement possible la réalité telle qu’elle est, sans artifice et sans idéalisation, avec des sujets et des personnages choisis dans les classes moyennes ou populaires. Le roman entre ainsi dans l'âge moderne et peut dorénavant aborder des thèmes comme le travail salarié, les relations conjugales, ou les affrontements sociaux. Ce mouvement s’étendra à l’ensemble de l’Europe et à l’Amérique.
Le fantastique est un registre littéraire qui se caractérise par l’intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste pour unrécit. Selon le théoricien de la littérature Tzvetan Todorov (voir son essai Introduction à la littérature fantastique), le fantastique se distingue du merveilleux par l'hésitation qu'il produit entre le surnaturel et le naturel, le possible ou l'impossible et parfois entre le logique et l'illogique. Le merveilleux, au contraire, fait appel au surnaturel dans lequel, une fois acceptés les présupposés d'un monde magique, les choses se déroulent de manière presque normale et familière. Le fantastique peut être utilisé au sein des divers genres : policier, science-fiction, horreur, contes, romances, aventures ou encore merveilleux lui-même. Cette définition plaçant le fantastique à la frontière de l'étrange et du merveilleux est généralement acceptée, mais a fait l'objet de nombreuses controverses, telle que celle menée parStanislas Lem1.
Le naturalisme est un mouvement littéraire qui, dans les dernières décennies du xixe siècle, cherche à introduire dans les romans la méthode des sciences humaines et sociales, appliquée à la médecine par Claude Bernard. Émile Zola est le principal représentant de cette école littéraire en France. Le mouvement s'étendra dans toute l'Europe ainsi qu'en Amérique.
Le terme parnasse, dans son usage commun, désigne la poésie en général et les poètes.
Le mouvement poétique appelé Parnasse est apparu en France dans la seconde moitié du xixe siècle : il tire son nom du recueil poétique le Parnasse contemporain publié entre 1866 et 1876 par l'éditeur Alphonse Lemerre. Il apparaît en réaction au lyrisme et aux sentiments du romantisme.
Ses principes sont la valorisation de l’art poétique par la retenue, l'impersonnalité et le rejet de l'engagement social ou politique. L'art n'aurait pas à être utile ouvertueux et son but en serait uniquement la beauté : le slogan « L'art pour l'art » de Théophile Gautier, considéré comme précurseur, est adopté. Ce mouvement réhabilite aussi le travail acharné et minutieux de l'artiste en utilisant souvent la métaphore de la sculpture pour symboliser la résistance de la « matière poétique».
Le symbolisme est un mouvement littéraire et artistique apparu en France et en Belgique à la fin du xixe siècle, en réaction au naturalisme et au mouvementparnassien.
Le mot est proposé par Jean Moréas, qui utilise ici l'étymologie du mot « symbole » (« jeter ensemble») pour désigner l'analogie que cette poésie souhaite établir entre l'Idée abstraite et l'image chargée de l'exprimer. Pour les symbolistes, le monde ne saurait se limiter à une apparence concrète réductible à la connaissance rationnelle. Il est un mystère à déchiffrer dans les correspondances qui frappent d'inanité le cloisonnement des sens : sons, couleurs, visions participent d'une même intuition qui fait du Poète une sorte de mage. Le symbolisme oscille ainsi entre des formes capables à la fois d'évoquer une réalité supérieure et d'inviter le lecteur à un véritable déchiffrement : d'abord voué à créer des impressions — notamment par l'harmonie musicale — un souci de rigueur l'infléchira bientôt vers la recherche d'un langage inédit. L'influence de Stéphane Mallarmé est ici considérable, ce qui entraîne la poésie vers l'hermétisme.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)










